Comme chaque année, Phileo by Lesaffre a organisé les Microbiota Days sur deux journées, en webinaire. L'édition 2023 s'est déroulée les 3 et 4 octobre. Retour sur quelques-unes des interventions axées sur les animaux de compagnie.
Juan Hernandez, professeur, chef du service de médecine interne à l'hôpital universitaire vétérinaire d'Oniris (Nantes) et chercheur à l'Inrae, a présenté le microbiote et l'inflammation intestinale chez le chien lors des Microbiota Days organisés par Phileo by Lesaffre les 3 et 4 octobre. Les chiens peuvent être sujets à des entéropathies inflammatoires, présentant des symptômes cliniques gastro-intestinaux tels que des vomissements, de la diarrhée et des lésions endoscopiques observables dans la lamina propria infiltrée par des entérocytes.
Chez l'Homme, l'équilibre du microbiote est perturbé en cas de dysbiose intestinale et d'inflammation, entraînant une diminution de la diversité des bactéries bénéfiques telles que les Bifidobacteria, Bacteroidetes, Akkermansia et Firmicutes, avec une augmentation des entérobactéries et protéobactéries. Des similitudes dans les observations sont notées chez les chiens, « suscitant la question cruciale : "comment le microbiote contribue-t-il au processus inflammatoire ?" ». « Les mécanismes de communication impliquant les récepteurs de reconnaissance, notamment le récepteur de type Toll, ont été largement étudiés. Autre exemple, le TLR 4 identifie les polysaccharides des bactéries gram négatives, déclenchant l'expression de gènes codant pour des cytokines inflammatoires », explique Juan Hernandez. Dans les études actuelles sur les chiens, quatre voies métaboliques sont explorées : la synthèse des acides gras à chaîne courte, la synthèse de l'indole à partir du tryptophane, la déconjugaison des sels biliaires avec la transformation en acides biliaires secondaires et enfin, l'activité protéolytique.
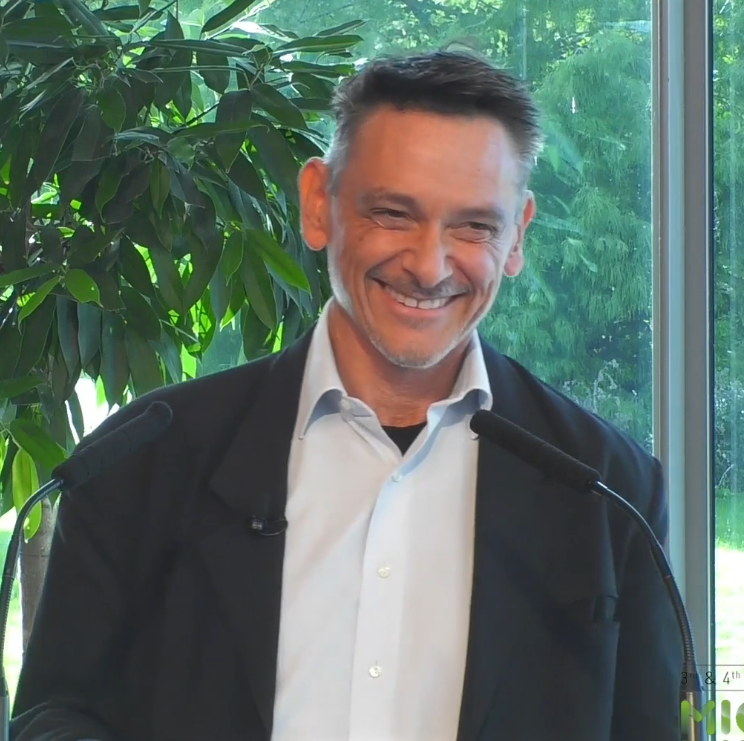
Étude des voies métaboliques
Une publication récente (Minamoto et al., 2019) souligne une diminution significative des acides gras dans les fèces des chiens souffrant d'entéropathies chroniques, notamment une réduction marquée de l'acétate et du propionate. Cette étude met également en lumière une corrélation entre la diminution des acides gras à chaîne courte et la réduction de Blautia spp., Faecalibacterium spp., Turicibacter spp. et C. hiranonis, conséquences de la dysbiose.
Une autre voie métabolique examinée concerne le métabolisme de l'acide biliaire. L'acide biliaire est produit dans le foie par le cholestérol. Les acides biliaires primaires sont conjugués à la taurine ou à la glycine. Ils sont envoyés dans le duodénum et 95 % de ces acides biliaires sont réabsorbés et entrent dans la circulation entérohépatique. Mais 5 % des acides biliaires sont envoyés dans le colon et y sont exposés au microbiote. Ils y sont déconjugués par l'hydrolase des sels biliaires (BSH), portée par des bactéries et sont transformés en acides biliaires secondaires par d'autres bactéries. « Chez un Homme sain, il y a une balance très importante entre les acides biliaires primaires et secondaires. Chez un sujet ayant une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, la déconjugaison est perturbée donc il y a un déséquilibre entre les acides biliaires primaires et secondaires. » Selon une étude (Blake et al., 2010), chez les chiens atteints d'entéropathie chronique, les acides biliaires sont significativement réduits, créant un déséquilibre similaire à celui observé chez les patients humains atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.
L'activité protéolytique représente une autre voie métabolique d'intérêt. L'homéostasie protéolytique est l'équilibre entre les protéases de l'hôte et du microbiote d'un côté et les inhibiteurs de l'hôte et du microbiote de l'autre. « Chez les Hommes souffrant de la maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse, on observe le déséquilibre par l'augmentation de l'activité protéolytique dans les fèces des patients. Lorsque l'on utilise un inhibiteur spécifique de sérine-protéase, le fluorure de phénylméthylsulfonyle (PMSF), on inhibe l'hyperactivité protéolytique, ce qui montre qu'elle est principalement due à la sérine-protéase. » Les chiens atteints d'entéropathie chronique présentent une augmentation significative de l'activité protéolytique des fèces (multipliée par cinq par rapport à un groupe témoin). Cette activité est inhibée avec le PMSF mais pas avec l'acide éthylène diamine tétra-acétique (EDTA) qui est un inhibiteur de métalloprotéinase, ni le E-64 qui est un inhibiteur de cystéine-protéase. « Cela confirme que l'hyperactivité protéolytique est due à la sérine-protéase. » Chez les patients atteints de la maladie de Crohn, les enzymes sont également hyperactives : la trypsine, l'élastase neutrophile, la protéinase 3 et la cathepsine G. « La même chose est observée chez les chiens. »
« La question est : "comment cette hyperactivité protéolytique peut induire ou contribuer à l'inflammation ?" » Une hyperactivité protéolytique entraîne un appauvrissement en mucus, une dégradation des jonctions serrées et l'activation des voies inflammatoires. Cela induit le processus des cytokines et du recrutement des neutrophiles engendrant l'activation des voies inflammatoires. Une étude utilisant L. lactis, productrice d'élafine, un inhibiteur de l'élastase, a montré une diminution des lésions inflammatoires microscopiques, ainsi que des cytokines et chimiokines. Le génome humain code 37 gènes pour les serpines, inhibiteurs de la sérineprotéase, dont seulement 30 sont fonctionnels. En revanche, le microbiome code plus de 1 000 gènes de serpines, soulignant son rôle potentiel dans la régulation de l'activité protéolytique. Giacomo Rossi, professeur et chercheur à l'université de Camerino (Italie), a présenté l'importance d'une bonne colonisation bactérienne. Pour cela, le professeur et chercheur a réalisé une étude sur les poulets avec l'administration in ovo (dans la poche amniotique), à trois jours avant éclosion, d'un probiotique associé à un extrait de contenu intestinal récupéré de duodénum et colon de poulets adultes sains. Trois groupes d'œufs ont été constitués pour l'essai : le premier a reçu 0,5 ml/œuf de 1 × 106 UFC de bactéries/ml, le deuxième groupe a reçu la même dose avec 1 × 105 UFC/ml, le troisième groupe a reçu 0,5 ml/œuf de solution saline. Les animaux ont été observés pendant 35 jours, puis à terme, une nécropsie, un pesage des organes, de l'histopathologie et des examens fécaux ont été réalisés. Les poulets des deux premiers groupes sont significativement plus lourds que le groupe témoin et leurs intestins sont significativement plus longs. Cela permet une plus grande absorption de différents nutriments avec plus de surface.

Interaction entre le microbiote et l'hôte
Giacomo Rossi a également étudié le microbiote et l'immunité innée sur le modèle des abeilles. Enfin, il a étudié le microbiote et l'immunité acquise sur vingt chiens sains divisés en deux groupes de dix. Un groupe a reçu le probiotique durant 60 jours. Les paramètres évalués étaient l'ingéré, la masse, le score fécal, la condition corporelle, les IgA fécales, la concentration en IgG plasmatique et la composition du microbiote fécal. Résultat : « de quatre semaines à huit semaines après le début de l'étude, le groupe ayant reçu le probiotique a significativement plus d'IgA fécales et d'IgG plasmatique que le groupe témoin. Pour la composition du microbiote fécal, les chiens ayant reçu le probiotique ont significativement plus de Bifidobacterium à huit semaines que les chiens ayant reçu le placebo et moins d'E. coli et de C. perfringens entre le début de l'étude et la huitième semaine. » Une étude sur trois groupes de chiens, portée sur les entéropathies, a montré que l'indice d'activité des maladies inflammatoires de l'intestin chez le chien diminuait autant avec le prébiotique qu'avec le traitement classique. Le TGF , facteur de croissance et le Fox P3 sont plus élevés chez les chiens ayant reçu le probiotique. Pour la composition du microbiote, les résultats étaient similaires à l'étude précédente : il y a une augmentation des bactéries (Lactobacillus, Turicibacter et Fecalibacterium) pour les chiens qui ont reçu le probiotique. « Cette augmentation traduit d'un bien-être du microbiote intestinal. »
Une autre pathologie a été étudiée : le syndrome du côlon irritable. Dix chiens (sains et atteints de ce syndrome) ont été observés. Ces derniers ont été supplémentés pendant 60 jours avec le probiotique. Une diminution de la masse cellulaire dans la muqueuse et la diminution d'aspect inflammatoire avec une augmentation des récepteurs cannabinoïdes ont été rapportées.
Enfin, une étude sur dix chats souffrant d'une constipation chronique a été réalisée. Après le traitement de probiotiques, une diminution du score inflammatoire de la muqueuse a été notée ainsi qu'une diminution du score clinique sur l'histologie. « Une bonne colonisation bactérienne, immédiatement après la naissance ou même dans les derniers stades du développement fœtal, peut être un outil pour éduquer le système immunitaire. L'utilisation de probiotiques est un outil d'intervention pour améliorer la réponse immunitaire innée et acquise chez tous les animaux (vertébrés et invertébrés) et pour restaurer les barrières muqueuses lors d'entéropathies chroniques, en réduisant la dysbiose. Les effets métaboliques des probiotiques sont essentiels pour une communication correcte entre l'intestin et les autres organes, mais aussi pour réduire une mauvaise activation immunitaire et les stimuli inflammatoires », conclut Giacomo Rossi.

Saccharomyces cerevisiae, levure probiotique
Achraf Adib Lesaux, responsable mondial de la R&D pour les animaux de compagnie chez Phileo by Lesaffre, a présenté les effets bénéfiques d'une levure de la société sur les chiens.
Cette dernière rappelle : « le microbiome de l'intestin joue un rôle important dans la santé de l'hôte : croissance, métabolisme, fonction et développement immunitaire, etc. Dans un intestin sain, il y a une homéostasie entre les bactéries et les métabolites, qui jouent un rôle dans la régulation de différents systèmes. » Une perturbation dans cet équilibre entraîne non seulement une inflammation, mais également un dysfonctionnement de la fonction de l'intestin. Différents traitements existent pour un dysfonctionnement : la modulation par l'alimentation, l'utilisation de pro- préet postbiotiques, la transplantation de microbiote fécal (FMT) ou l'utilisation d'antibiotiques.
Achraf Adib Lesaux a partagé des résultats d'un essai visant à évaluer les effets d'un probiotique à base de levure Saccharomyces cerevisiae chez le chien avant et après un changement rapide d'alimentation. Seize chiens adultes de race Beagle ont été divisés en deux groupes : un groupe témoin et un supplémenté avec le probiotique (0,12 g/j/ chien) durant 49 jours, le changement d'alimentation s'est fait au jour 22. Des échantillons de sang étaient prélevés durant toute la période.
La responsable R&D présente les résultats : « les analyses fécales ont révélé que les chiens supplémentés avec le probiotique avaient un pH fécal significativement plus faible au jour 49, ce qui est en lien avec la concentration en ammoniac fécal plus faible et la moindre quantité d'amines biogènes totales, ainsi que moins d'indole, phénol et p-crésol fécaux. Lorsque l'on regarde les acides gras à chaîne courte dans les fèces, il y a plus de butyrate. Le butyrate joue un rôle d'inhibiteur dans le process inflammatoire. Les analyses du microbiote ont montré que l'index de dysbiose est significativement amélioré avec le probiotique. La composition du microbiote est marquée par significativement plus de Turicibacter et significativement moins d'E. coli avec le probiotique. La diversité du microbiote ne montre pas de différence statistique de l'-diversité entre les deux groupes mais une différence significative de la β-diversité entre les deux groupes. »
Elle conclut : « la supplémentation en levure probiotique S. cerevisiae chez le chien sain peut améliorer les indicateurs de la fonctionnalité gastro-intestinale, en réduisant la concentration fécale de certains catabolites fermentaires azotés et en augmentant la concentration fécale globale de butyrate, quel que soit le régime alimentaire. Elle module le microbiote intestinal et ses fonctions, favorisant l'eubiose et l'homéostasie intestinale et réduisant les pathogènes potentiels, tels que E. coli. De futures études sont nécessaires pour évaluer son effet sur un plus grand nombre d'animaux à différents stades de la vie et sur d'autres modèles de maladies. »
Stéphanie Blanquet-Diot, directrice adjointe de l'Unité microbiologie, environnement digestif et santé (Medis) à l'université Clermont Auvergne, a présenté les modèles intestinaux in vitro, une plateforme puissante pour la recherche sur le microbiome dans le domaine de la nutrition et de la santé animales. Cette dernière explique : « ce sont des systèmes dynamiques et multi-compartimentaux qui simulent l'intégralité du tractus gastrointestinal, pour éviter les contraintes règlementaires et éthiques et réduire les animaux utilisés dans les essais, comme le mentionne la règlementation européenne des 3R (Réduire, Réutiliser, Recycler). Cela permet la standardisation des protocoles expérimentaux et la reproductibilité, la flexibilité technique, l'accès à tous les compartiments digestifs sans utiliser de techniques invasives et pas seulement la mesure du point final. Enfin, c'est une réduction du coût des expériences, comparé à des essais in vivo. » La suite de son intervention présentait ce modèle, les applications possibles et les limites du modèle.




