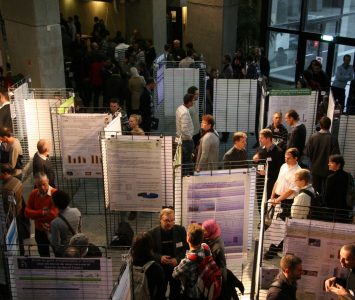Plusieurs événements ont animé l’actualité de la filière cunicole française ces derniers mois. La journée Itavi, l’assemblée générale de la Fenalap, Fédération des groupements de producteurs de lapin, et la conférence organisée par l’interprofession Clipp à l’occasion du Space. Ils permettent de dresser un bilan de la filière, ses enjeux et ses actualités notamment sous l’angle de l’alimentation animale.

« La France est le deuxième pays producteur de lapins en Europe, derrière l’Espagne et devant l’Italie, avec un volume de viande estimé à̀ 50 000 tonnes équivalent carcasse et environ 800 éleveurs professionnels en 2018 », présente Guy Airiau, éleveur et président de l’interprofession Clipp.
Le suivi de la production présenté lors de l’assemblée générale de la Fenalap en décembre 2018 dresse un état des lieux de la filière cunicole française : « L’année 2017 a été particulièrement impactée par les cessations d’activité. Le potentiel de production a perdu plus de 25 240 femelles. Les causes de ce déclin sont principalement liées à des prix trop bas ne rémunérant par les producteurs, à la VHD, maladie hémorragique virale qui a touché environ 25 % des élevages cunicoles français en 2017 », commente Serge Lefevre, éleveur et président de la Fenalap, la Fédération des groupements de producteurs. Les premiers chiffres de 2018 suivent la même tendance : la perte est de 21 100 femelles sur le premier semestre 2018. Selon l’interprofession, le Clipp, les effectifs nationaux de lapines reproductrices s’établissent à 732 000 têtes en 2017. Pour rappel, ils étaient de 1 376 000 têtes en 2000 soit un repli de -47 % sur la période. Selon la dernière note de conjoncture de l’Itavi : « Les inséminations artificielles des 45 premières semaines 2018 s’établissent à 3,3 millions de femelles contre 3,6 en 2017 soit une baisse de -9 %. »
En termes d’aliment, cela se traduit par un repli de -7 % des fabrications nationales en 2017 par rapport à 2016 et de -25,8 % par rapport à 2010. Selon Coop de France et le Snia, les fabrications d’aliments pour lapin s’établissent à 301 548 tonnes en 2017. Sur les dix premiers mois de l’année 2018, les fabrications d’aliments sont en repli de -9 % par rapport à la même période en 2017.
640 g/habitant/an
La production souffre de la chute de la consommation. Selon l’Itavi : « En 2018, la consommation par habitant est estimée en repli de -6,8 % par rapport à 2017 soit une consommation par habitant s’établissant à 640 g par habitant. En 2017, la consommation individuelle de viande et préparations de lapin s’établissait à 690 g/hab, contre 1 480 g/hab en 2000. » Sur une échelle de temps plus grande, la consommation a été divisée par deux sur les vingt dernières années.
Sur ce sujet, l’interprofession Clipp avait organisé une conférence au Space intitulée Le lapin et les Français, comment favoriser la reprise de la consommation ? Les données présentées étaient basées sur une étude réalisée par l’Ifop à la demande de FranceAgriMer et du Clipp. « Le recul de la consommation tient plus de la modification des habitudes alimentaires que de considérations liées aux modes d’élevage », affirme Fabienne Gomant, directrice adjointe du pôle opinion et stratégies d’entreprises à l’Ifop qui présentait les données. En effet, cette étude de l’Ifop met en évidence que « la consommation de lapin reste stable chez les Français (80 % contre 82 % en 2010), même les plus jeunes déclarent en manger (69 % des 15 à 24 ans). En revanche, la fréquence de consommation baisse, avec moins de consommateurs réguliers (15 % déclarent manger du lapin au moins une fois par mois, proportion en recul de 10 points) et un plus grand nombre de consommateurs très occasionnels (10 % en mangent moins souvent qu’une fois par an, proportion en progression de 7 points) ». Les conclusions de l’étude sont que « le lapin bénéficie d’une image plutôt positive pour la plupart des consommateurs mais manque aujourd’hui de visibilité. Pourquoi ne pas le mettre davantage à la carte des restaurants ? L’étude identifie également d’autres leviers pour encourager la consommation de viande de lapin : l’origine France, la valorisation de l’alimentation des lapins, 100 % végétale et/ou sans OGM, le développement de l’offre Label Rouge et bio. Mieux communiquer sur les atouts nutritionnels de cette viande saine et peu calorique auprès des consommateurs permettrait également de moderniser son image, auprès de consommateurs de plus en plus soucieux de leur alimentation. » À ce sujet le Clipp vient de se voir accorder un budget de 2 514 000 euros pour les années 2019, 2020 et 2021 au titre d’un programme européen de promotion de la viande de lapin sur les marchés français et allemand.

Sur le front sanitaire et sociétal
Outre la déconsommation, le lapin souffre depuis plusieurs années d’une grave crise sanitaire liée à la VHD, maladie hémorragique virale. Il en fut largement question lors de la dernière journée Itavi. Isabelle Bouvarel, ingénieur à l’Itavi rappelle que « cette maladie hautement infectieuse est souvent fatale : 60 à 100 % des lapins meurent entre 48 et 72 heures après l’infection ». Depuis 2010 un nouveau génotype est apparu échappant partiellement à l’immunité dirigée contre les souches classiques. « Elle entraîne une durée de maladie un peu plus longue, un taux de mortalité très variable allant de 30 à 80 % avec une plus forte proportion de forme chronique et une capacité à infecter et à induire des mortalités chez les très jeunes lapereaux », décrit Isabelle Bouvarel. La filière s’accorde à dire qu’environ 25 % des élevages ont été touchés par la maladie en 2017 et que cette situation a entraîné ou accéléré de nombreuses fermetures d’élevages. La filière s’est donc accordée pour construire un plan collectif volontaire de lutte à base de communication, de mesures de biosécurité, de vaccination des reproducteurs et d’un suivi des cas avérés. En outre, « la maladie a été placée en danger sanitaire de catégorie 2 depuis le 31 mai 2018, explique Yann Nédélec, animateur à la Fenalap. Un programme d’indemnisation de la maladie vient d’être mis en place au sein de la section avicole du FMSE, le fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental ».
L’autre grand sujet de réflexion de la filière cunicole est le bien-être en élevage. L’Itavi a décliné son outil Ebene pour le lapin. Laura Warin, ingénieur à l’Itavi en expliquait l’esprit et le fonctionnement lors de la dernière journée Itavi : « C’est un outil d’auto-évaluation du bien-être qui s’appuie sur les nouvelles technologies et sur une méthode scientifique innovante issue des protocoles scientifiques d’évaluation du bien-être animal reconnus, Welfare Quality et Awin. » Il a été conçu en collaboration avec des scientifiques, des professionnels de l’élevage ainsi que des ONG œuvrant pour la protection animale comme Welfarm et Ciwf. Il se compose d’une grille d’évaluation basée sur les quatre grands principes du bien-être : l’alimentation, l’environnement, la santé et le comportement. « La méthode privilégie les indicateurs de résultats et repose sur l’observation des animaux, dans leur comportement et leur état sanitaire. Elle est complétée par des indicateurs de moyens. L’application smartphone permet d’évaluer un lot d’animaux et de produire des résultats sous la forme d’un graphique radar pour visualiser immédiatement les points forts et les points faibles à améliorer », décrit Laura Warin. Ebene est gratuit pour les éleveurs et les entreprises peuvent en acheter des licences. C’est le choix qu’a fait Inzo° : « Nous y voyons un bel outil pour permettre aux techniciens des usines d’aliment d’ouvrir le dialogue sur le thème du bien-être avec leurs éleveurs. Nous encourageons nos partenaires à mener des campagnes d’audit pour permettre aux éleveurs de se saisir du bien-être, un sujet dont ils se sentent dépossédés. Or ils sont au cœur de ces préoccupations, car ce sont eux qui prennent soin des animaux. Ebene leur permettra de reprendre la parole sur ce sujet », illustre Chantal Davoust, responsable marché lapin pour Inzo°.
F. Foucher