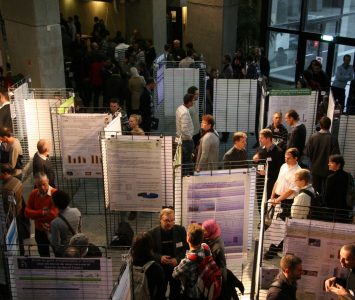La journée technique organisée par l'Institut du Porc avait pour but d’évaluer l'impact environnemental du porc, de l'élevage à l'abattoir, et de développer ses voies d'amélioration.
La production porcine représente une émission de 2,7 kg de CO2/kg de porc vif... les matières premières représentent 89 % du bilan carbone des aliments pour animaux... le transport
…