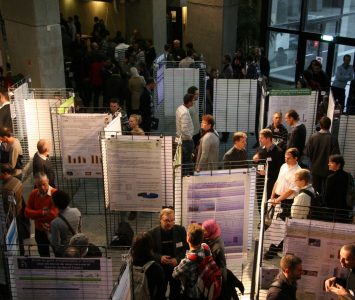Sous la pression de la lutte antidopage, les substances naturelles alimentaires prohibées (SNAP) constituent un challenge complexe à relever pour les marques d’alimentation équine. Si la plupart des fabricants fait désormais valoir la charte qualité rédigée par le Cnef, une minorité d’entre eux conteste ses conditions d’application et préfère, au risque de brouiller le message de la profession, faire cavalier seul. Analyse.
« Le dopage à l’insu de son plein gré », n’est pas une boutade pour les chevaux. Le dopage involontaire ne fait absolument pas rire le monde de l’alimentation équine. C’est même un thème de cauchemar pour toute la filière. « Les codes des courses au trot et au galop prévoient de lourdes sanctions quand un cheval est confirmé positif. En courses, les chevaux sont systématiquement disqualifiés et perdent leur prix de courses et les allocations correspondantes. Selon les substances détectées, ils peuvent être interdits de courir pendant de longs mois », rappelle la Fédération Nationale des Courses Françaises. « L’entraîneur est toujours jugé responsable de la faute ou de la négligence, même s’il bénéficie de circonstances atténuantes ou si un phénomène de contamination externe est reconnu. Il peut se voir infliger une amende allant jusqu’à 15 000 euros, voire plus en cas de récidive. Il peut également faire l’objet d’un retrait de licence d’entraîneur ». Les entraîneurs ne sont pas les seuls touchés. Les marques d’alimentation pour chevaux de compétition ont beaucoup à perdre également en cas de contrôle positif à la suite de contamination par des substances naturelles alimentaires prohibées (SNAP). « Ce peut être catastrophique », confirme Éric Touzaint, le nouveau président du Cnef (Club de Nutrition Equine Français).

C’est que la triche au champ de course ne contrevient pas seulement à la morale sportive, elle met aussi en cause toute l’économie de la filière de l’élevage de chevaux puisque « le premier objectif de la compétition équestre est la sélection des reproducteurs », rappelle la FNCF. Les sommes en jeu sont colossales. Du coup « la lutte anti-dopage est encore plus sévère pour les chevaux de compétition que pour les sportifs humains. Toutes les substances sont interdites et il n’y a pas de seuil de tolérance pour les analyses d’urine ou de sang des chevaux », explique le docteur Yves Bonnaire, directeur du Laboratoire des Courses Hippiques.
La lutte antidopage s’intensifie sur les champs de course : les contrôles ont augmenté de 30 % en 6 ans, révélant ainsi 88 cas positifs en 2009 cas contre 53 en 2003, selon les dernières informations de la FNCF. Les contrôles sont en revanche beaucoup moins fréquents pour les autres sports équestres, où le taux de contrôle positif serait pourtant beaucoup plus élevé. Dans la grande majorité des cas, les enquêtes menées par les vétérinaires de France Galop ou de France Trot font apparaître des causes accidentelles. En 2004, une enquête de ENESAD (Établissement National Enseignement Agronomique de Dijon) devenu depuis Agrosup, estimait que 85 % des cas positifs de dopage relevaient de causes involontaires. Toutes ne sont pas cependant d’origine alimentaire. Depuis, un guide de bonnes pratiques a été mis en place en 2005 sans pour autant que l’on en mesure précisément son impact. Quoi qu’il en soit, le risque des contaminations des aliments par des substances dopantes ne peut être négligé. « Chaque année nous identifions plusieurs cas », confirme le docteur Paul-Marie Gadot, de France Galop, sans donner plus de précision sur les producteurs d’aliments incriminés. « À notre connaissance aucune marque adhérente au Cnef n’a été touchée », assure Éric Touzaint.
Prévention pour les approvisionnements
Les SNAP sont sournoises et peuvent contaminer de nombreuses matières premières. Des doses infimes, bien en deçà du niveau des doses efficaces, suffisent à rendre un cheval positif au contrôle anti-dopage. Aucune fabrication d’aliment ne peut donc être à l’abri sans mesures de préventions.
La caféine, la théobromine et la théophylline se retrouvent dans des produits communs de l’alimentation humaine, chocolat, thé, café. Certains résidus comme des cabosses de cacao sont communément utilisés pour l’alimentation pour bétail. L’atropine et la scopolamine proviennent de plantes qui comme le datura poussent dans les champs et contaminent presque systématiquement les tourteaux de tournesol. La morphine se retrouve aussi à l’état naturel en France dans des pavots cultivés ou sauvages, qui peuvent contaminer les autres cultures, de luzerne notamment. La filière a eu dans un passé récent à déplorer des contaminations par ces substances naturelles. Il convient aussi de préciser qu’au niveau des doses détectées, les SNAP n’ont aucune incidence sur les performances des chevaux.

Les sources de contaminations des aliments par les SNAP sont de deux principales sortes : premièrement l’utilisation de matières premières contaminées, deuxièmement les contaminations croisées au sein des chaînes de fabrication par des aliments préparés pour d’autres animaux.
Les industriels contrôlent donc de manière très poussée leurs approvisionnements. La prévention contre les SNAP nécessite une surveillance beaucoup plus sensible que pour des démarches qualité conventionnelles. « Le Laboratoire des courses hippiques(LCH) utilise des spectromètres de masse en couplage à la chromatographie gazeuse ou liquide », explique Dr Yves Bonnaire, son directeur. « Ce sont des techniques qui relèvent plus de la pharmacie que de l’agroalimentaire », prévient-il. Bref, le contrôle anti-dopage s’effectue avec une précision 1 000 fois supérieure à ce que des analyses de qualité classiques exigeraient.
Objectif zéro SNAP
Depuis trois ans, la pratique s’intensifie et se généralise. En 2009, le LCH a effectué 1 400 contrôles préventifs pour le compte des industriels de l’alimentation équine ; en 2010 plus de 2000 et le total de 2011 dépassera 3 500 (si la tendance enregistrée durant les 7 premiers mois se confirme). Le taux de contrôles positifs justifie la vigilance des fabricants puisque les analyses du LCH détectaient en 2007 la présence de SNAP dans 15 % des échantillons (aliments et compléments confondus). Les efforts des industriels sur la maîtrise des approvisionnements semblent porter leurs fruits puisque les taux d’échantillon positif des 7 premiers mois de 2011 s’établissaient à 11 %. Toutefois, il n’est pas exclu que des variations saisonnières puissent expliquer aussi cette inflexion de la courbe. Cette tendance à la baisse mériterait confirmation.
Quoi qu’il en soit, ces contrôles préventifs effectués par le LCH prouvent qu’ils sont parfaitement justifiés et permettent de bloquer des approvisionnements à risques. De ce point de vue les coûts des analyses du LCH, de l’ordre de 90 € HT l’unité, apparaissent comme un investissement dérisoire dans le contexte de l’alimentation équine.
L’analyse à l’entrée d’usine des matières première ne suffit cependant pas à annihiler tous les risques. Les contaminations des aliments pour chevaux peuvent aussi intervenir sur les chaînes de fabrications. Il suffit en effet de quantités relativement réduites pour contaminer un lot. Comme les contaminations accidentelles ne seraient pas homogènes, les industriels ne peuvent donc pas compter sur l’effet de dilution pour bénéficier d’un seuil de tolérance et d’une marge d’erreur. « L’objectif est de zéro SNAP dans les aliments », insiste Éric Touzaint.
Du coup, les industriels du CNEF ont adopté en juillet 2007 une charte qualité spécifique à l’alimentation du cheval reposant sur 8 points et marquant l’engagement des professionnels pour la maîtrise du risque. Neuf marques se sont engagées : Destrier, DP Nutrition, Dynavena, Equi Gold, Royal Horse, Sanders, Spillers, Team et Uar. Chez Destrier, l’engagement est toutefois restrictif et ne concerne que les produits « garantie Or ».
François Delaunay
... Retrouvez l'intégralité de l'article dans la RAA 651 - Novembre 2011