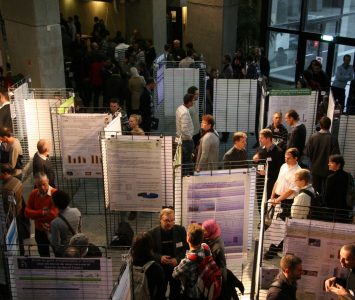Lors de sa journée technique dédiée aux volailles, le 19 mai dernier à Pornic, la firme-services Idena a donné son analyse du marché, rappelé ses axes de recherche, notamment en nutrition précoce, amorcé une réflexion sur la durabilité des productions d’aliments et donné la parole à un spécialiste de l’application de la norme bien-être en poulet.

Toutes productions confondues, l’aliment pour volailles demeure la première production nationale avec 8 451 milliers de tonnes. Mais il accuse une chute de 13 % sur les 10 dernières années. « La production de poulets de chair est stable sur les dix dernières années », analyse Renaud Domitile, président de la firme-services Idena et chef de produit du marché avicole. Elle a perdu un peu moins de 3 %, après être passée par des phases de très fortes baisses entre 2004 et 2007. Cela s’explique par une hausse de la productivité en kg / m2 / an, en moyenne de 2,6 % par an, soit plus de 50 % en 10 ans. Elle est due à l’augmentation de la densité qui a augmenté de 24 % entre 1984 et 2007. Le poids moyen, lui, s’est stabilisé autour de 1,8 à 1,9 kg, ce qui correspond à la demande des abattoirs et qui représente un poids plus faible que dans les autres pays européens. L’âge à l’abattage est stable depuis une dizaine d’années et semble correspondre à un seuil physiologique. L’indice de consommation stagne depuis 1999 autour de 1,8 et semble atteindre un pallier. Pourtant la génétique avance, elle a donc du mal à être valorisée sur le terrain. Au final, la moindre pression de l’import en 2009-2010 a permis à la filière de progresser de 1,6 % cette année. Cette progression est également tirée par une consommation en hausse de 3,5 %, principalement sur les produits de découpe. Mais les importations restent en hausse, de 7 %, et 40 % de la consommation n’est pas produite en France : « Il y a donc de la place pour une production française, surtout les produits de découpe, or la France n’est pas forcément la mieux placée sur ce segment de marché. »
Axes de recherche
Pour Idena, « les enjeux pour cette filière reposent dans la gestion de l’augmentation du prix de production causée en partie par l’augmentation du coût de l’aliment ; la filière doit aussi faire face au renouvellement de son parc bâtiment pour ne pas voir son potentiel de production s’éroder ; enfin, cette production doit continuer d’améliorer sa compétitivité, par la baisse de l’indice de consommation et l’abaissement de l’âge à l’abattage c’est-à-dire une optimisation du potentiel génétique développé par les sélectionneurs. »
(...)
La dinde est la production qui accuse la plus forte baisse : « Elle a perdu 40 % en 10 ans, analyse Renaud Domitile. C’est une situation française, car dans d’autres pays comme en Allemagne elle a continué d’augmenter, ce qui a valu l’arrivée de nouveaux compétiteurs en Europe : Pologne, Allemagne notamment, qui n’étaient pas présents sur ce marché il y a 10 ans. La productivité a stagné depuis quelques années, mais elle a gagné 34 % en 10 ans. Le poids moyen a gagné 44 % depuis 1985 et se poursuit parce que le marché s’oriente vers des dindes plus lourdes. L’indice de croissance lui a augmenté de 4,4 % sur cette période, car il a été fortement dégradé par le passage aux formules 100 % végétales après les années 2000. Contrairement au poulet, la dinde a vu sa mortalité croître. » L’un des enjeux majeurs de cette filière semble être l’adaptation des abattoirs à l’alourdissement des souches.
Pour cette espèce, Idena étudie particulièrement « les besoins en acides aminés secondaires, les besoins alimentaires différentiels des souches, la prévention des troubles locomoteurs pour les souches lourdes, la réduction des pododermatites, via la qualité de la litière ».
(...)
Nutrition in ovo
Pierre Desbordes, vétérinaire spécialiste aviculture pour la firme-services, a fait le point sur les stratégies nutritionnelles précoces : « C’est un sujet qui nous préoccupe depuis une dizaine d’années, nous en parlions déjà lors de nos journées techniques en 2001. » Il en a rappelé l’enjeu : « Les volailles doivent se nourrir dès leur naissance. En l’absence de nourriture, elles perdent du poids vif lors des premières 24 heures et cette perte se maintient jusqu’au poids final. Or la fenêtre d’éclosion est plus ou moins longue, allant de 24 à 36 heures, et au bout du compte, en comptant le temps de vacciner puis de transporter, il peut se passer plus de 24 heures, 48 heures voire 72 heures entre la naissance et la distribution du premier repas à l’élevage. » Pendant ce laps de temps, les jeunes oiseaux connaissent une période de jeûne et de déshydratation. Le jeûne entraîne une baisse de l’hormone thyroïdienne T3 qui altère la thermorégulation, avec comme effet une perte de poids allant jusqu’à 4 g de poids vif, ainsi qu’une sensibilité plus accrue aux agents infectieux. « 1 g de poids vif gagné à l’âge de 7 J se traduit par 5 g de poids vif à 7 semaines : le but de l’alimentation précoce est donc d’enclencher ce cercle vertueux », rappelle Pierre Desbordes.
Pour comprendre la nécessité de cette alimentation précoce, le vétérinaire rappelle le processus de l’embryogénèse du poussin, qui peut se résumer en 3 phases : la première semaine répond à un métabolisme anaérobie ; les deux semaines suivantes voient l’oxygène traverser la coquille et permettre une croissance très rapide au terme de laquelle l’embryon est structurellement achevé. Enfin, la dernière semaine, lorsque l’œuf est transféré à l’éclosoir, la respiration se fait aérienne, quand le processus de bêchage est enclenché. Lors de toute cette période, les acides gras du vitellus constituent le « carburant » essentiel à la croissance de l’embryon.
(...)
Durabilité de la formulation
Alexandre Calendreau, responsable formulation - matières premières pour Idena, a imaginé que la durabilité devienne un critère de formulation : « En association avec l’Afca-Cial, le Snia et Coop de France, Tecaliman a engagé une étude pour fournir aux fabricants des informations concernant leur impact environnemental », rappelle-t-il. Avec toutes les précautions d’usage concernant les méthodologies qui ne sont pas validées par des normes officielles, il en ressort que l’empreinte carbone des aliments est principalement due à la production des matières premières qu’ils mettent en œuvre : pour 92 % pour une formule vache laitière par exemple, le transport n’entrant qu’à hauteur de 5 % et la fabrication elle-même de 3 %...
Françoise Foucher
... Retrouvez l'intégralité de l'article dans la RAA 647 - juin 2011